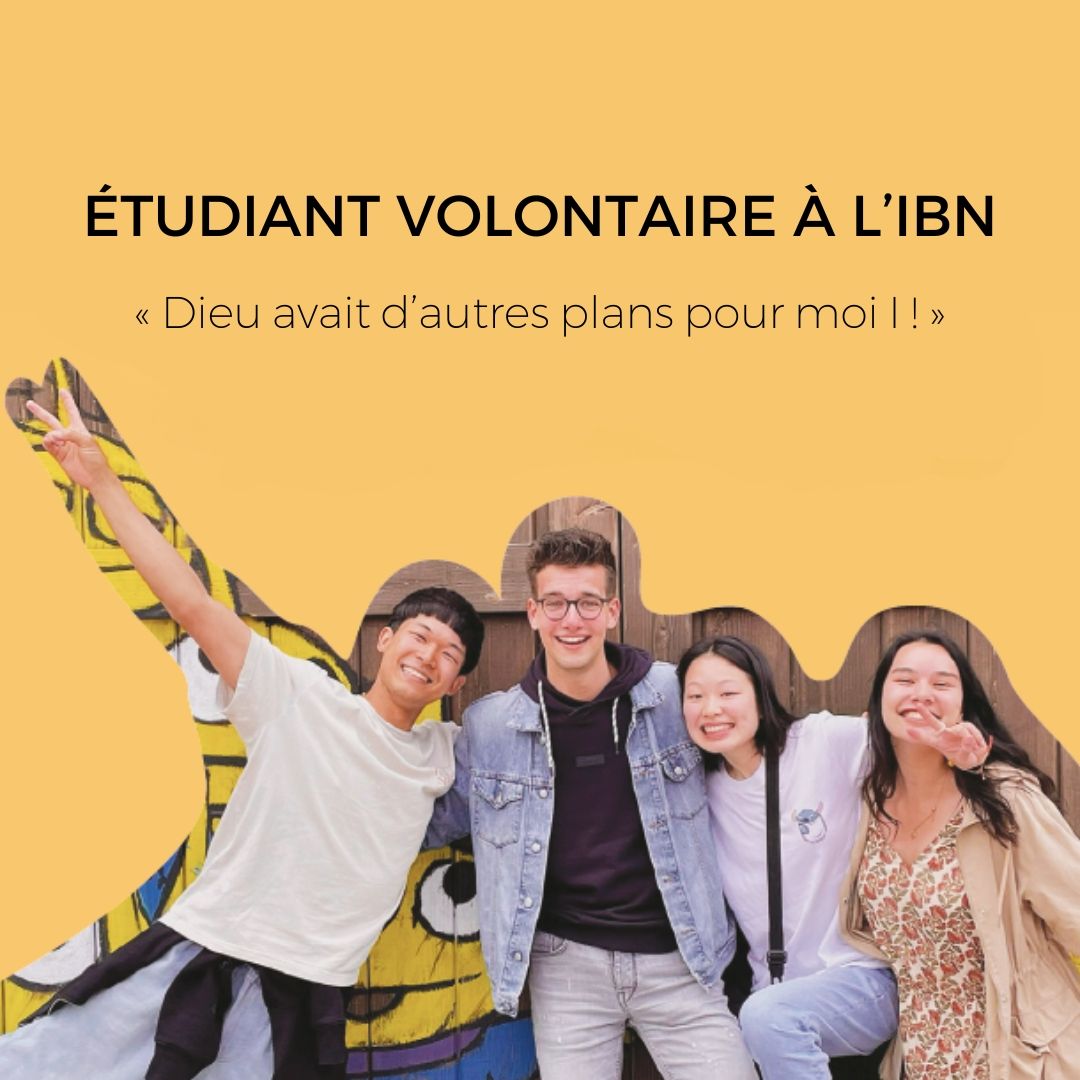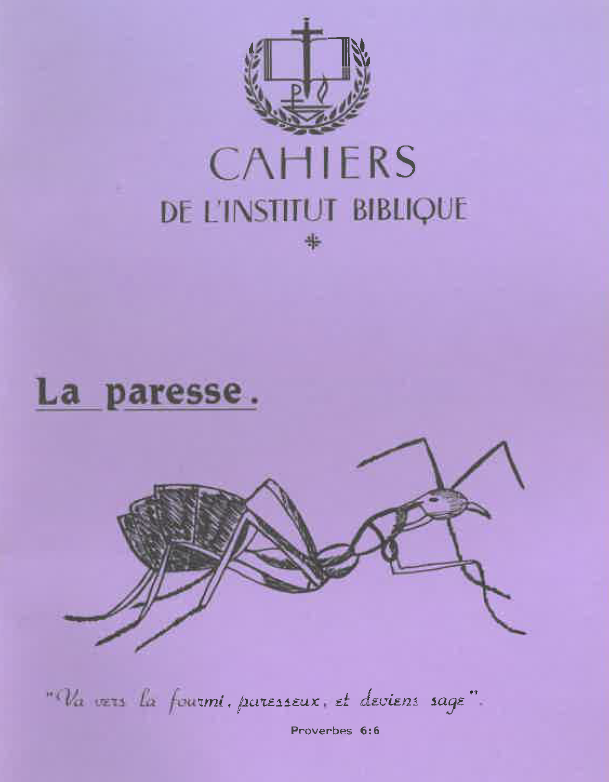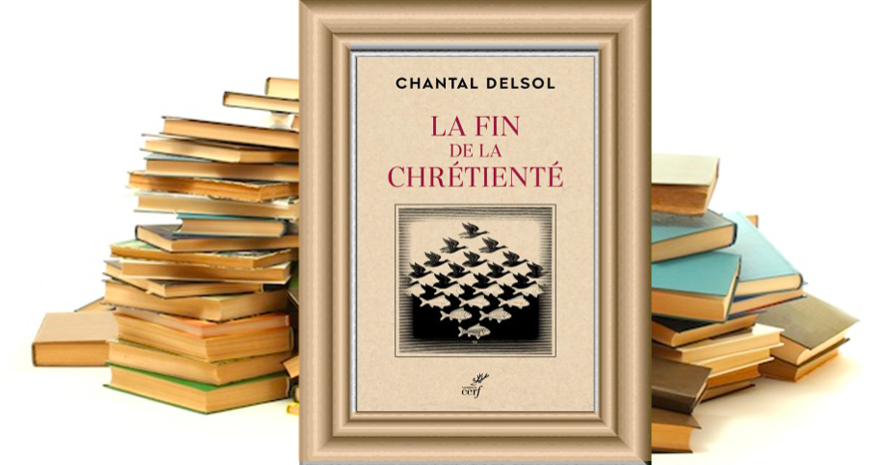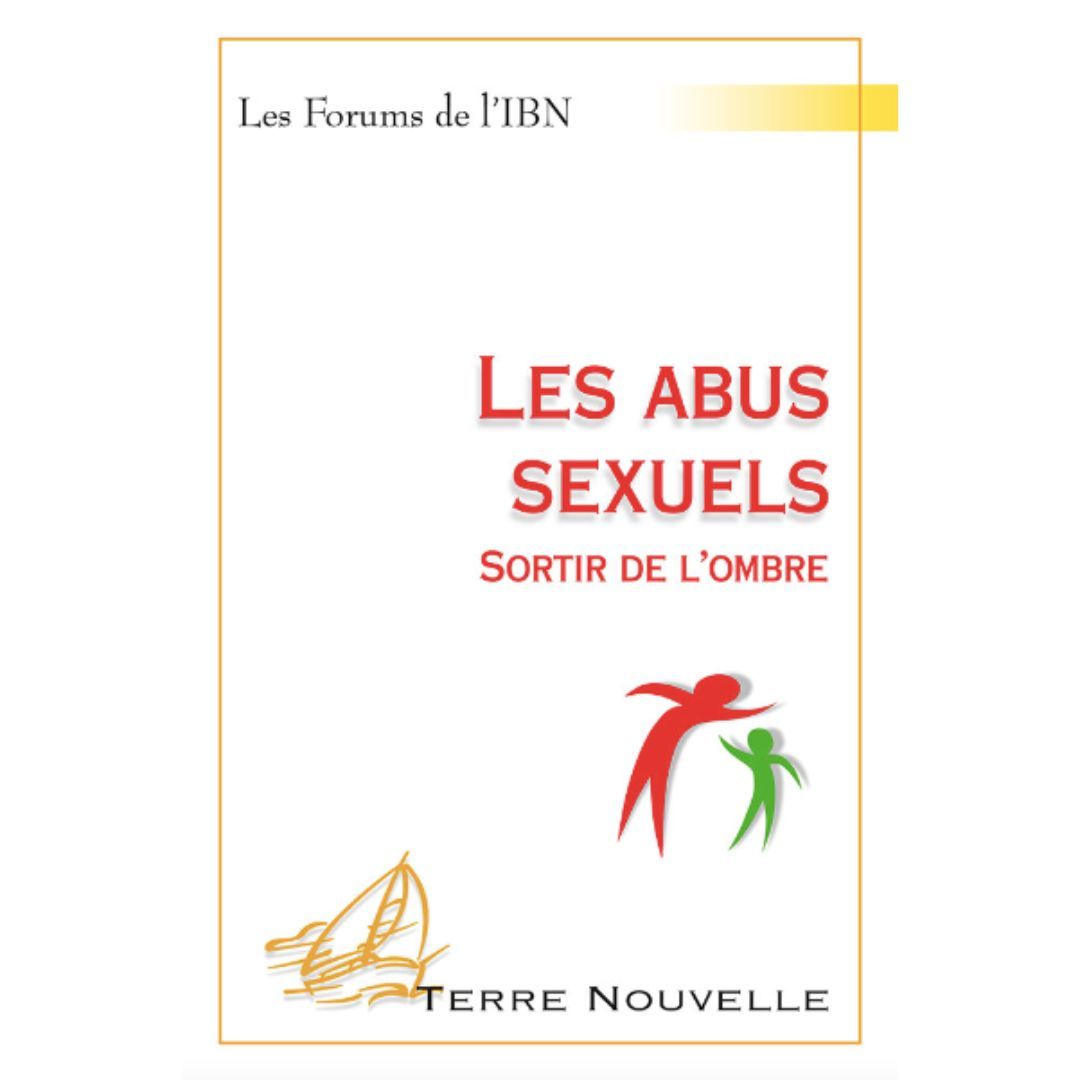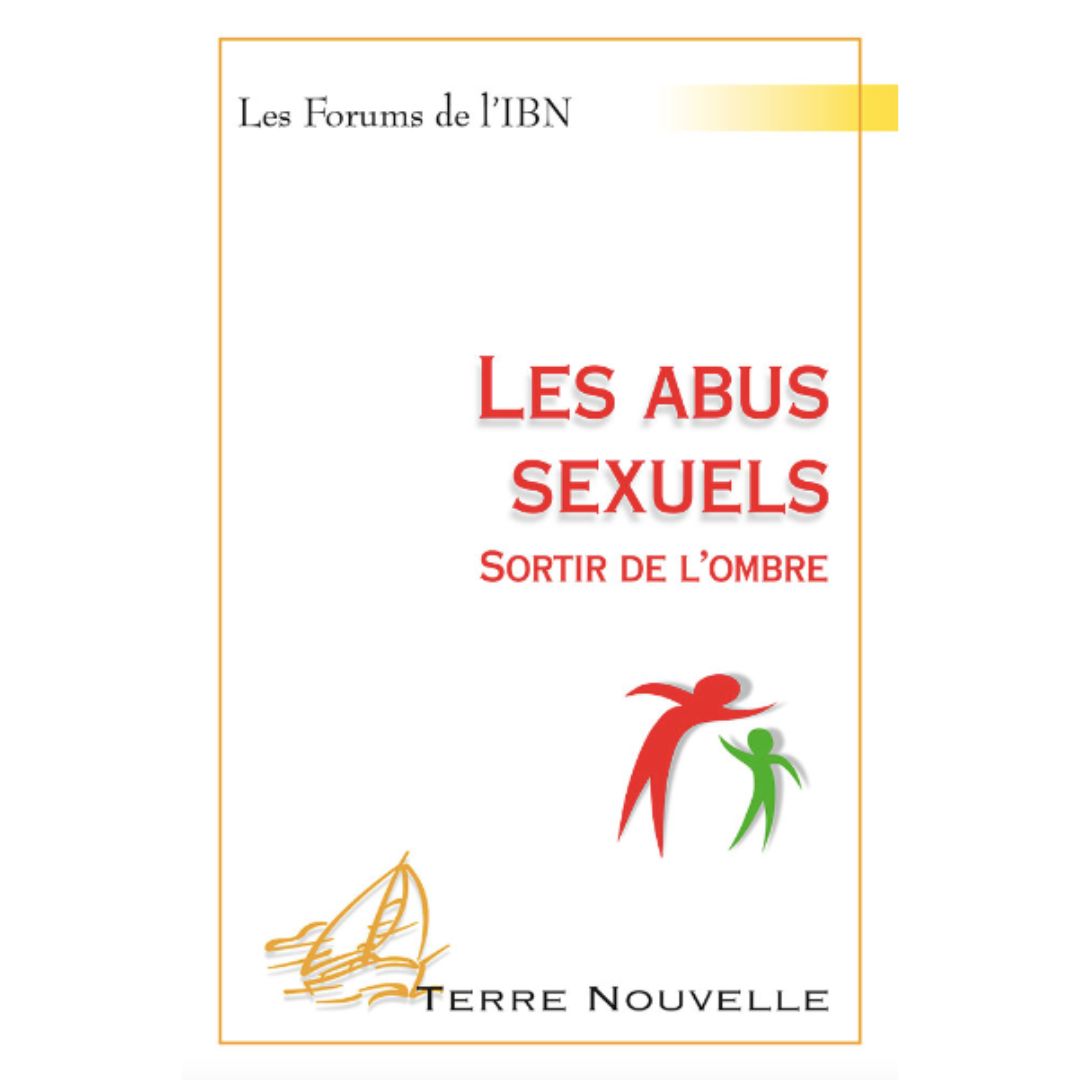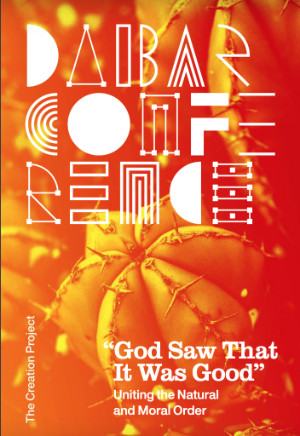1. Deux montagnes : Sinaï et Sion (Hé 12.18-24)
L’auteur de l’épître aux Hébreux, dans notre passage, établit un contraste saisissant entre le Mont Sinaï, lieu du don de la Loi, et le Mont Sion, lieu auquel sont appelés les croyants de la nouvelle alliance : « Vous ne vous êtes pas approchés, en effet, d’une montagne[1] qu’on pouvait toucher » (v. 18). Dans l’Ancien Testament, la révélation accordée au Sinaï avait culminé dans la construction du temple sur le Mont Sion. Mais l’épître aux Hébreux inclut toute l’ancienne alliance dans ce terme « Mont Sinaï » et fait ressortir que la nouvelle alliance est la réalité vers laquelle l’attente de l’ancienne pointait.
Pour décrire les terreurs au Sinaï, l’auteur fait appel au récit qu’en fait le livre de l’Exode (19.10-20 ; 20.18-21), et aux souvenirs de Moïse quand il parla 40 ans plus tard au peuple avant l’entrée dans le pays de Canaan (Dt 4.11s). Il y a bien un paradoxe ici : Israël est au bénéfice d’une révélation palpable, matérielle – comme nous en rêvons parfois nous-mêmes – mais la sainteté divine est tellement terrifiante qu’ils ne peuvent même pas toucher la montagne ! Seul Moïse, en tant que médiateur de l’alliance peut gravir le Sinaï[2]. Mais lui aussi est habité par la peur : « Je suis épouvanté et tout tremblant » (Hé 12.21)[3].
Le tableau menaçant que l’auteur brosse de la révélation accordée au Sinaï sert d’arrière-fond sombre pour mieux faire ressortir les privilèges des croyants de la nouvelle alliance : alors que les Israélites ne pouvaient même pas toucher la montagne sous peine de mort, les croyants de la nouvelle alliance se sont « approchés » de la montagne de Sion. La sainteté de Dieu reste la même : « notre Dieu est aussi un feu dévorant », comme le rappelle l’auteur au verset 29. Mais au lieu d’être « terrifiante et inaccessible », dans la nouvelle alliance, la sainteté divine « accueille, purifie et guérit[4] ». Non pas parce que Dieu aurait, tout à coup, baisser ses exigences – comment pourrait-il ne pas punir le péché, lui dont « les yeux sont trop purs pour voir le mal » (Ha 1.13) ? Mais dans la nouvelle alliance, la justice de Dieu, inaccessible dans le régime de la Loi est enfin accomplie. L’accès à la cité de Dieu est garanti par le sang de Jésus, comme le précise le verset 24 : son sacrifice expiatoire nous garantit un libre accès à la présence de Dieu.
« Vous vous êtes approchés… » (v. 22) : Le verbe grec se trouve au parfait, pour désigner une action du passé qui donne lieu à un état continu. Il fait référence à la conversion à Jésus-Christ, qui a introduit les croyants dans cette nouvelle sphère d’existence qui est désormais la leur[5]. L’auteur décrit cette réalité nouvelle à l’aide de huit expressions, groupées en quatre paires :
- La montagne de Sion : Comme les tribus d’Israël convergent vers Jérusalem pour célébrer le culte du Seigneur (Ps 122.3s), ainsi les croyants de la nouvelle alliance viennent se rassembler à la rencontre de Dieu.
- La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste : La cité céleste émerge comme un thème majeur dans la dernière partie de l’épître aux Hébreux. Au chapitre 11, l’auteur la place au centre de l’attente des patriarches (v. 10, 16). Au chapitre 13, elle est la cité à venir, la seule à laquelle le chrétien doit sa loyauté, en acceptant le rejet du monde opposé à Christ (v. 13s). Dans notre texte, elle est cette patrie céleste à laquelle les chrétiens appartiennent dès à présent.
Nous connaissons cette même dualité du livre de l’Apocalypse : la nouvelle Jérusalem est cette ville eschatologique qui apparaîtra quand le ciel descendra sur terre et que Dieu habitera parmi les hommes (Ap. 21.2s). Mais dès à présent, la montagne de Sion désigne le lieu où le culte est rendu à l’Agneau dans les cieux. Certes, aujourd’hui cette ville n’est pas encore descendue sur terre, la louange céleste reste encore cachée à nos yeux. Mais nous appartenons, dès à présent, à cette compagnie céleste. Ou pour employer un langage paulinien : nous sommes « assis dans les lieux célestes avec Christ » (Ép. 2.6)[6]. Notre Seigneur est déjà entré dans la présence du Père et règne du ciel ; c’est pourquoi nous, membres de son corps, nous sommes citoyens du ciel : c’est « la Jérusalem d’en haut … qui est notre mère » (Ga 4.26), non une quelconque ville des royaumes d’ici-bas.
- Des myriades d’anges en fête : Le terme grec désigne une « réunion de fête » et est probablement à prendre avec ce qui précède comme complément circonstanciel, comme le fait la TOB et la Semeur, et en accord avec les manuscrits grecs qui comportent des ponctuations et les versions latine et syriaque[7]. Il n’est pas surprenant de trouver une multitude d’anges dans la présence de Dieu (Dt 33.2, selon la leçon des Septante ; Dn 7.10 ; Ap 5.11). L’ambiance festive contraste avec l’austérité qui entourait le don de la Loi. Jésus lui-même souligne que les anges se réjouissent « pour un seul pécheur qui se repent » (Lc 15.10). Il y a beaucoup de raisons de célébrer au ciel, depuis que la justice a été accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ. Et si les anges font la fête, nous aussi, n’est-ce pas ?
- L’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux : c’est-à-dire nous. Nous sommes tous des enfants privilégiés – privilège que nous devons tenir en estime, contrairement à l’attitude d’Ésaü, dénoncée quelques versets plus haut (v. 16). Comme les premiers-nés de l’exode, nous sommes protégés par le sang de notre Agneau pascal (cf. Hé 11.28) ; nous sommes « inscrits dans les cieux », c’est-à-dire sûrs de notre salut[8].
- Dieu, le Juge de tous (cf. Gn 18.25 : « le Juge de toute la terre ») : L’accent sur le rôle de Juge souligne la responsabilité solennelle des auditeurs et prépare la mise en garde qui conclura l’énumération (cf. Hé 4.13 ; 10.30s). En même temps, il fait ressortir d’autant mieux la solidité de notre espérance : que craindre encore si nous sommes approuvés par le Juge de tous, inscrits dans son livre de vie ?
- Des esprits des justes parvenus à la perfection : Les croyants qui nous ont précédés dans la mort sont accueillis par Dieu dans sa présence. Ils ont achevé leur course ; le temps de l’épreuve et de la vigilance est passé pour eux. Pourtant, ce n’est pas leur mérite, mais la grâce de Dieu qui les a soutenus jusqu’au bout : c’est le Christ qui « peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu par lui » (Hé 7.25). Voici notre destinée finale : nous pouvons reprendre courage, car d’autres avant nous sont déjà arrivés jusqu’au bout.
- Jésus : en point d’orgue de l’énumération. Comme l’exprime N.T. Wright, il est « le couronnement glorieux de la nouvelle Jérusalem[9] ».
- Son sang nous permet l’accès à la Jérusalem céleste ; car il « parle mieux que celui d’Abel » : alors que le sang d’Abel criait vengeance, le sang de Jésus, symbolisant sa mort à notre place, proclame haut et fort que nous sommes réconciliés avec Dieu, puisque justice a été faite.
L’auteur brosse devant nous « une image dramatique, exaltante, glorieuse »[10]. C’est la réalité que nous vivons, le privilège qui est le nôtre. Pourtant, ce tableau grandiose nous interpelle aussi : « Votre vie de prière et d’adoration, que ce soit seul ou avec d’autres croyants, est-elle empreinte de la joie et de l’enthousiasme qui se dégagent de ces versets ?[11] »
3. Deux ébranlements : de la terre seulement, et de la terre et des cieux ensemble (v. 26-27)
Deux montagnes, deux paroles – et encore deux ébranlements : « Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant il nous a fait cette promesse : Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel » (v. 26).
Un ami kabyle m’a raconté son expérience du tremblement de terre en Algérie : une expérience très déroutante, car le sol se dérobe sous les pieds ; ce qui paraît le plus immobile – la terre – ne nous porte plus ! Mais imaginez alors un tremblement qui ébranle terre et ciel. N’est-ce pas la seule chose qui fait vraiment peur aux Gaulois invincibles : « Que le ciel nous tombe sur la tête » ! Comme si Dieu prenait le monde actuel fermement entre ses deux mains et le secouait, pour que tout ce qui est péché, mauvais, soit éliminé[15]. Ce qui reste, c’est Jésus ; ceux qui lui appartiennent ; le monde nouveau qui a déjà commencé dans la cité de Dieu, cité qui existe dès à présent et qui est encore à venir, et à laquelle nous appartenons en tant que chrétiens.
Regardons de plus près ces deux ébranlements :
- L’ébranlement de la terre fait référence aux événements extraordinaires qui avaient accompagné le don de la Loi au mont Sinaï[16].
- L’ébranlement de la terre et du ciel provient de la promesse donnée en Aggée 2.6, que l’auteur cite selon la version des Septante[17] : « Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. ». La prophétie avait été donnée en 520, au moment de la reconstruction du temple, après l’exil babylonien. Malgré la modestie de l’entreprise, bien misérable en comparaison avec le temple originel de Salomon, vu les moyens limités des personnes revenant de l’exil (Ag 2.3s ; cf. Esd 3.12), le Seigneur promet que « la gloire de cette dernière maison sera plus grande. » Car, « c’est dans ce lieu que je donnerai la paix », annonce le Seigneur (Ag 2.9) – promesse qui s’est réalisée quelques 550 ans plus tard. Ce même temple était encore debout quand le Fils de Dieu est venu sur terre ; c’est bien dans ce temple qu’il a enseigné. C’est là que notre Seigneur a dit : « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2.19).
L’ébranlement total qu’Aggée entrevoit s’accompagne de l’ébranlement des nations (Ag 2.7). Il aura pour conséquence que la résistance des ennemis sera brisée (v. 22) et que les nations afflueront à Jérusalem, pour apporter leurs richesses dans le temple (v. 7). Ces promesses s’accomplissent pour les chrétiens.
De nouveau, nous retrouvons cette double dimension de la réalité déjà présente et encore à venir :
- Dès à présent, nous sommes libérés de toutes les forces du mal, car Christ a triomphé d’elles à la croix (Col 2.15). Nous appartenons déjà à ce royaume inébranlable, à ce nouveau monde inauguré à la résurrection de Jésus.
- En attendant la victoire finale, nous aspirons encore à voir la nouvelle Jérusalem descendre du ciel sur terre, « les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire » (Ap 21.24).
4. Vivre sur terre comme des citoyens du ciel (12.28-29)
Si l’auteur de l’épître aux Hébreux revient à l’attente eschatologique au chapitre suivant (13.14), dans notre passage, l’accent tombe sur les conséquences, ici et maintenant, de notre appartenance au royaume inébranlable. Car dans la Bible, l’espérance eschatologique a toujours des répercussions très concrètes. Dès aujourd’hui, nous sommes appelés à vivre sur terre comme des citoyens du ciel.
Qu’est-ce qui change dans notre vie si nous comprenons vraiment le privilège qui est le nôtre : d’appartenir, dès à présent, à la cité de Dieu ? L’auteur met en avant deux aspects de notre réponse : la reconnaissance et le service : « Puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en servant Dieu d’une manière qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte » (v. 28).
- La gratitude[18] pour toutes les bontés du Seigneur : les bénédictions matérielles, la santé, et avant tout le salut. Nous appartenons à la communion des saints ; nous pouvons parler librement à Dieu dans la prière ; notre destinée éternelle est assurée – tout cela nous ne le méritons pas. C’est par la grâce que nous venons nous présenter devant Dieu ; et Dieu nous accueille parce que le sang de Jésus crie réconciliation.
- Le service : Peut-être est-ce ici la première, et la plus importante réponse à la crise des vocations : nous stimuler mutuellement dans cette attitude de reconnaissance. Nous rappeler quel privilège extraordinaire est le nôtre : nous appartenons à cette communauté où tous sont prêtres et rois. Justement, il n’y a plus de caste sacerdotale à part, mais nous sommes tous appelés à servir Dieu. Il n’y a pas qu’un seul homme, descendant d’Aaron, qui peut entrer dans le saint des saints, une fois par an, mais nous tous qui croyons en Jésus et en son sacrifice expiatoire, nous nous sommes approchés de Dieu. Et si nous comprenons quel est ce Dieu dont nous nous sommes approchés, nous le servirons « avec crainte et profond respect », comme le traduit la Bible du Semeur. Car « notre Dieu est un feu dévorant » – ou, si vous me permettez un emprunt aux Chroniques de Narnia : Aslan n’est pas un « lion apprivoisé »[19].
Le chapitre suivant de l’épître dira très précisément en quoi consiste ce service agréable à Dieu. Et ce qui suit a de quoi nous surprendre : ce n’est pas d’abord une liste de ministères exercés dans l’Église, une énumération d’activités que nous classerions dans la catégorie « spirituelle ». Mais c’est l’amour fraternel (Hé 13.1) ; l’hospitalité (v. 2) ; le soutien aux prisonniers et à ceux qui sont maltraités (v. 3) ; la pureté sexuelle et le respect du mariage (v. 4) ; le détachement par rapport à l’argent et la confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins (v. 5-6) ; la mémoire chérie de ceux qui nous ont annoncé la parole de Dieu et qui nous ont précédés dans la gloire (v. 7).
Servir en route vers la cité céleste
Il serait utile de se demander ce qui devrait changer dans la vie de nos Églises, dans nos discussions entre chrétiens et dans nos programmes de formation, si nous prenions à cœur ce que l’épître aux Hébreux a à nous dire sur le service agréable à Dieu. Sans tenter d’apporter une réponse élaborée à cette question, je voudrais vous laisser avec une piste de réflexion parmi bien d’autres.
En droite ligne avec l’exhortation de nous laisser inspirer par l’exemple de nos conducteurs qui ont tenu bon jusqu’au bout, j’ai pensé à Billy Graham et la stratégie qu’il avait adoptée pour ne pas céder aux trois tentations classiques du responsable, que nos amis anglophones résument dans le slogan : « sex, power, money », que l’on pourrait rendre par « voir, avoir, pouvoir ». Ces mêmes tentations sont abordées dans la liste des exhortations pour le service agréable à Dieu au treizième chapitre de l’épître aux Hébreux. Assez tôt dans son ministère public (en 1948), Billy Graham avait demandé à ses compagnons de service de se retirer pendant une heure, pour que chacun réfléchisse aux difficultés que les évangélistes rencontrent. Ensuite ils ont mis en commun leurs résultats et ont pris quatre résolutions, pour s’en prémunir. Ce que l’on est venu à appeler le « Manifeste de Modesto », d’après la ville en Californie où ils étaient réunis, concernait quatre domaines : l’intégrité financière, la pureté sexuelle, le partenariat avec les Églises locales, sans esprit de critique, et la véracité dans la communication[20].
Il me semble que cette liste n’a rien perdu de son actualité. Quelles résolutions aurons-nous, à notre tour, à prendre pour nous engager d’abord, et persévérer ensuite, dans le service de Dieu « qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. » ?
________Lydia Jaeger
[1] Les citations bibliques dans l’article suivent la traduction dite à la Colombe (par endroits légèrement retouchée).
[2] Les meilleurs manuscrits grecs ne comportent pas de nom, alors que le texte reçu a « montagne ». De toute façon, ce mot est sous-entendu (cf. v. 22).
[3] Samuel BÉnÉtreau, L’Épître aux Hébreux, coll. Commentaire Évangélique de la Bible, Vaux-sur-Seine, Édifac, tome 2, 1990, p. 193.
[4] Ce dire de Moïse n’est pas rapporté en lien avec le don initial de la Loi, mais on trouve une parole proche après l’incident du veau d’or (Dt 9.19). Il est plausible que l’épître aux Hébreux fasse un télescopage des différents événements qui se sont déroulés au Sinaï. F.F. Bruce, The Epistle to the Hebrews, coll. The New International Commentary on the New Testament, Grand Rapids, Eerdmans, 1990rev, p. 355, considère possible que notre texte se réfère à une tradition haggadique qui attribuerait de tels sentiments à Moïse lors de la révélation de la Loi. Étienne mentionne des sentiments similaires pour Moïse au moment de la révélation au buisson ardent (Ac 7.32).
[5] N.T. Wright, Hebrews for Everyone, London, SPCK, 2003.
[6] De ce verbe dérive le mot « prosélyte ». Bruce, op. cit., p. 355, cite Philon qui, dans un passage sur la vision de Dieu par Moïse (Ex 33.13-23), dit de ceux qui ont la même disposition de s’attacher à la vérité, et non aux fables, que Moïse « les appelle “prosélytiques”, car ils “se sont approchés” d’une nouvelle communauté qui aime Dieu. » Le verbe s’y trouve aussi au parfait.
[7] En prêchant (en trois séries) « au fil de » l’épître aux Hébreux, j’ai été frappée par la proximité entre la théologie de l’épître et celle de Paul : plus d’une fois, le meilleur verset pour résumer l’enseignement d’un passage se trouvait chez… Paul ! Il ne m’étonne donc plus que d’aucuns dans l’Antiquité ont attribué cette lettre à Paul, malgré le langage déployé assez différent. Cette observation soutient l’idée que l’auteur était quelqu’un de l’entourage de Paul ; cf. la mention de Timothée, 13.23.
[8] Bruce, op. cit., p. 353, n. 131.
[9] L’interprétation adoptée est celle (parmi d’autres) de Bénétreau, Bruce, Wright. D’autres voient dans les « premiers-nés » les anges, car créés avant les humains. Mais Bruce, op. cit., p. 358, souligne que la notion d’être inscrit aux cieux s’applique toujours à des hommes (Lc 10.20 ; Ap 21.27, etc.). Calvin et Bengel avaient compris les « premiers-nés » comme les croyants de l’ancienne alliance, venus avant les croyants de la nouvelle alliance, mais sans parvenir à la perfection sans eux (Hé 11.39-40). Pourtant, le texte indique nous nous sommes approchés de l’assemblée des premiers-nés, précision qui manque pour les anges et suggère que les lecteurs en font partie. Ainsi, l’expression doit englober l’Église militante sur terre et l’Église glorifiée au ciel.
[10] Wright, op. cit., p. 162: « the crowning glory of the new Jerusalem ».
[11] Wright, op. cit., p. 163.
[12] Ibid.
[13] BÉnÉtreau, op. cit., p. 200. L’expression « couronné de gloire et d’honneur » provient de Hé 2.7, 9, qui cite Ps 8.6.
[14] De telles exhortations solennelles sont une marque de fabrique de l’épître aux Hébreux : 2.1-4 ; 3.12s ; 4.1 ; 6.4-8 ; 10.25-31 ; 12.15-17 ; etc.
[15] Je reprends cette image de Wright, op. cit.
[16] La référence peut être à Ex 19.18, mais la Septante, que l’auteur suit habituellement, évacue l’idée d’ébranlement physique. De toutes les façons, l’élément est bien présent dans des reprises poétiques de l’événement, pour faire ressortir le caractère spectaculaire des phénomènes : Jg 5.4 ; Ps 68.8s. On le trouve aussi pour la traversée de la mer Rouge : Ps 77.19 ; il fait partie du décor habituel des théophanies (Ps 18.8 ; 82.5 ; Es 6.4 ; Am 9.5 ; Jb 9.6 ; références recueillies dans BÉnÉtreau, op. cit., p. 201).
[17] Brian Tidiman, Les livres d’Aggée et de Malachie, coll. Commentaire Évangélique de la Bible, Vaux-sur-Seine, Édifac, 1993, p. 117, explique la situation textuelle par rapport à cette variante.
[18] BÉnÉtreau, op. cit., p. 205, discute les deux traductions possibles et les arguments avancés respectivement : « tenons bien la grâce » (retenue par la TOB et la Bible de Jérusalem) ; et « soyons reconnaissants » (adoptée par la BC, NBS, BFC, NFC, Semeur). Bénétreau privilégie la première traduction, contre la majorité des modernes.
[19] En anglais : « He is not a tame lion », un lion dompté.
[20] https://billygraham.org/story/the-modesto-manifesto-a-declaration-of-biblical-integrity (consulté le 18 novembre 2023).