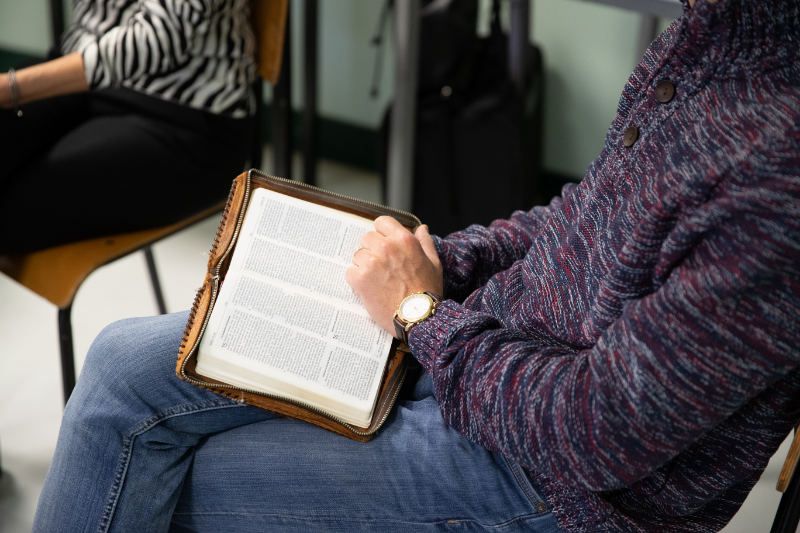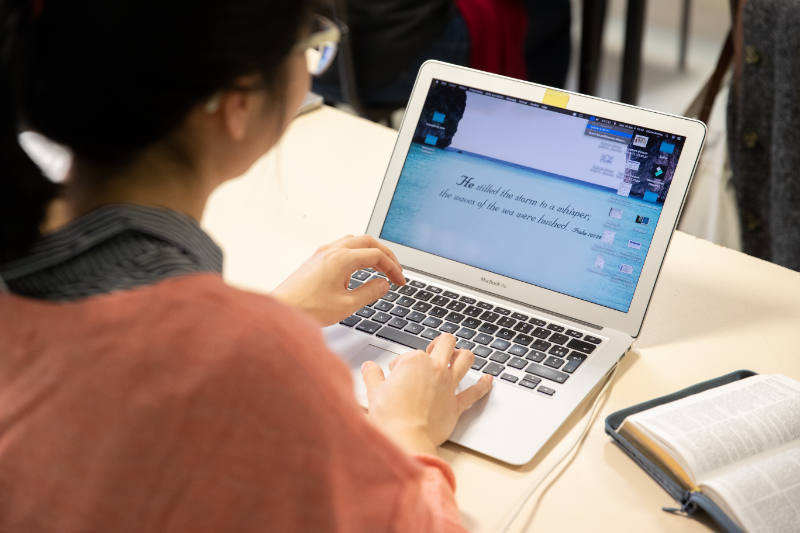Pourquoi lire l’Ancien Testament ?
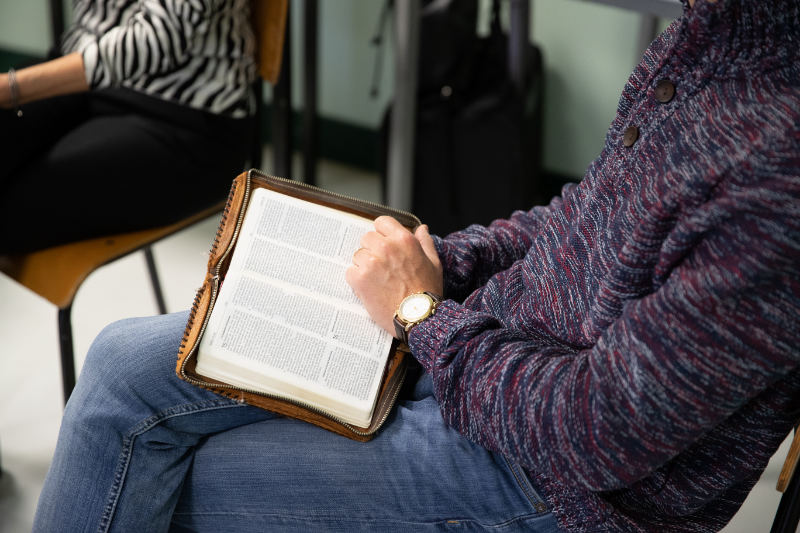
Le 22 Avril 2022
Pourquoi lire l’Ancien Testament ?
Mon Église vient de commencer un survol de la Bible : à l’école du dimanche, pour les enfants, et, en parallèle, au culte pour les adultes. Quand j’ai préparé la leçon sur la Genèse, je me suis souvenu de chrétiens exprimant leurs difficultés face à l’Ancien Testament : coutumes et us éloignés des nôtres, récits guerriers remplis de violence, textes de loi impossibles à appliquer tels quels, oracles prophétiques énigmatiques… si le Nouveau Testament accomplit les attentes et prédictions de l’Ancien, pourquoi se soucier encore de ce qui l’a précédé ?
Le Père de Jésus-Christ est le Dieu de l’Ancien Testament
C’est une des premières hérésies à laquelle la jeune Église a dû faire face : des gnostiques, comme Marcion au 2e siècle, ne pouvaient pas admettre que le Dieu créateur, à l’origine du monde matériel, était le Dieu bon qui se révèle en Jésus-Christ. Son canon, première liste de livres bibliques qui soit parvenue jusqu’à nous, exclut l’Ancien Testament (et ne retient qu’une version tronquée du Nouveau).
L’appellation « Ancien Testament » pour la première partie de la Bible se trouve déjà chez Paul (2 Co 3.14) ; et l’auteur de l’épître aux Hébreux n’hésite pas à écrire de ses dispositions rituelles qu’elles appartiennent à l’ancien régime ; « or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est près de disparaître » (Hé 8.13). Mais l’Église n’a jamais vacillé dans sa conviction que la Bible hébraïque est Parole de Dieu, au même titre que le NT. Paul, tout en étant « l’apôtre des païens » (Gal 2.18), souligne l’importance des écrits de l’ancienne alliance : « Tout ce qui a été consigné autrefois dans l’Écriture l’a été pour nous instruire, afi n que la patience et l’encouragement qu’apporte l’Écriture produisent en nous l’espérance » (Rm 15.4).
L’Ancien Testament à l’IBN
Un feuillet de juillet 1921, qui informe des donateurs britanniques du projet de lancer un « French Bible Training Institute » à Nogent, précise que le programme d’études inclura l’étude de chaque chapitre de la Bible. Si nous peinons à mettre totalement en pratique l’objectif affiché de nos fondateurs, cela reste l’objectif de l’Institut : conférer à l’étudiant une solide connaissance de tous les livres de la Bible. 28 crédits (qui correspondent à environ 730 heures d’étude investies par l’étudiant) sont consacrés à l’étude de l’AT au cours des trois années, ce qui constitue plus de la moitié (53 %) des crédits consacrés à la Bible.
L’actualité de l’Ancien Testament
Pourquoi accorder une telle place à l’étude de l’AT dans la formation de pasteurs, missionnaires et évangélistes ? Les raisons en sont diverses :
• Il est impossible de comprendre le Nouveau Testament sans solide connaissance de l’Ancien. Les personnages connus de la Bible hébraïque – Adam et Eve, Abel et Caïn, Hénoch, Noé, Abraham et Sarah, Isaac… peuplent aussi les pages du NT. L’épître aux Hébreux présente un commentaire théologique approfondi de personnes et institutions clé de l’ancienne alliance.
• L’Ancien Testament inscrit l’existence du croyant dans une histoire plurimillénaire. Une telle profondeur est d’autant plus précieuse dans un contexte où la plupart de nos Églises en France sont de fondation récente, de surcroît quand les histoires familiales ne facilitent pas la conscience d’être héritier d’une longue tradition (ruptures relationnelles, migration…).
• Nous suivons l’exemple de Jésus et des apôtres. Environ 10 % des paroles de Jésus sont des citations ou des allusions directes de l’AT. Les discours des Actes sont truffés de citations bibliques. Si Paul évite la preuve scripturaire face aux non-croyants païens sur l’Aréopage (Ac 17), il y a largement recours dans ses épîtres, même quand les Églises auxquelles il écrit sont composées majoritairement de croyants de cet arrière-plan, convertis depuis peu (comme c’est le cas à Corinthe).
• L’Ancien Testament contient des leçons de vie irremplaçables. Une psychologue chrétienne me faisait remarquer la naïveté de nombreux croyants, qui sousestiment les ramifications persistantes du mal dans nos familles et communautés. Quel meilleur antidote que de méditer les récits des patriarches, des juges et des rois, avec leurs lots de rivalités entre frères, de violences faites aux femmes, de doutes devant les promesses de Dieu… Qui connaît l’AT sait que le message de la Bible n’est pas que les croyants sont géniaux, mais que Dieu mène jusqu’au bout son oeuvre de salut (cf. Gn 50.20 ; Rm 5.20). L’Ancien Testament nous apprend à glorifier Dieu dans la vie quotidienne. La doctrine de la création, développée surtout dans l’AT, fournit le cadre d’une spiritualité de la vie ordinaire : servir Dieu à la maison et au travail, puisque ce monde ordinaire, « séculier », est créé par Dieu, et l’homme est appelé à le gérer en vice-régent (Gn 1.28 ; 2.15). La littérature sapientiale apporte des éclairages précieux pour la mise en pratique : Job devant l’énigme du mal, Proverbes avec des conseils très pratiques, le Cantique célébrant la beauté de l’amour conjugal, Qohélet faisant face à la fi nitude de l’existence humaine.
Vive les cours de l’Ancien Testament à l’Institut ! Vive sa lecture dans nos Églises !
Lydia JAEGER